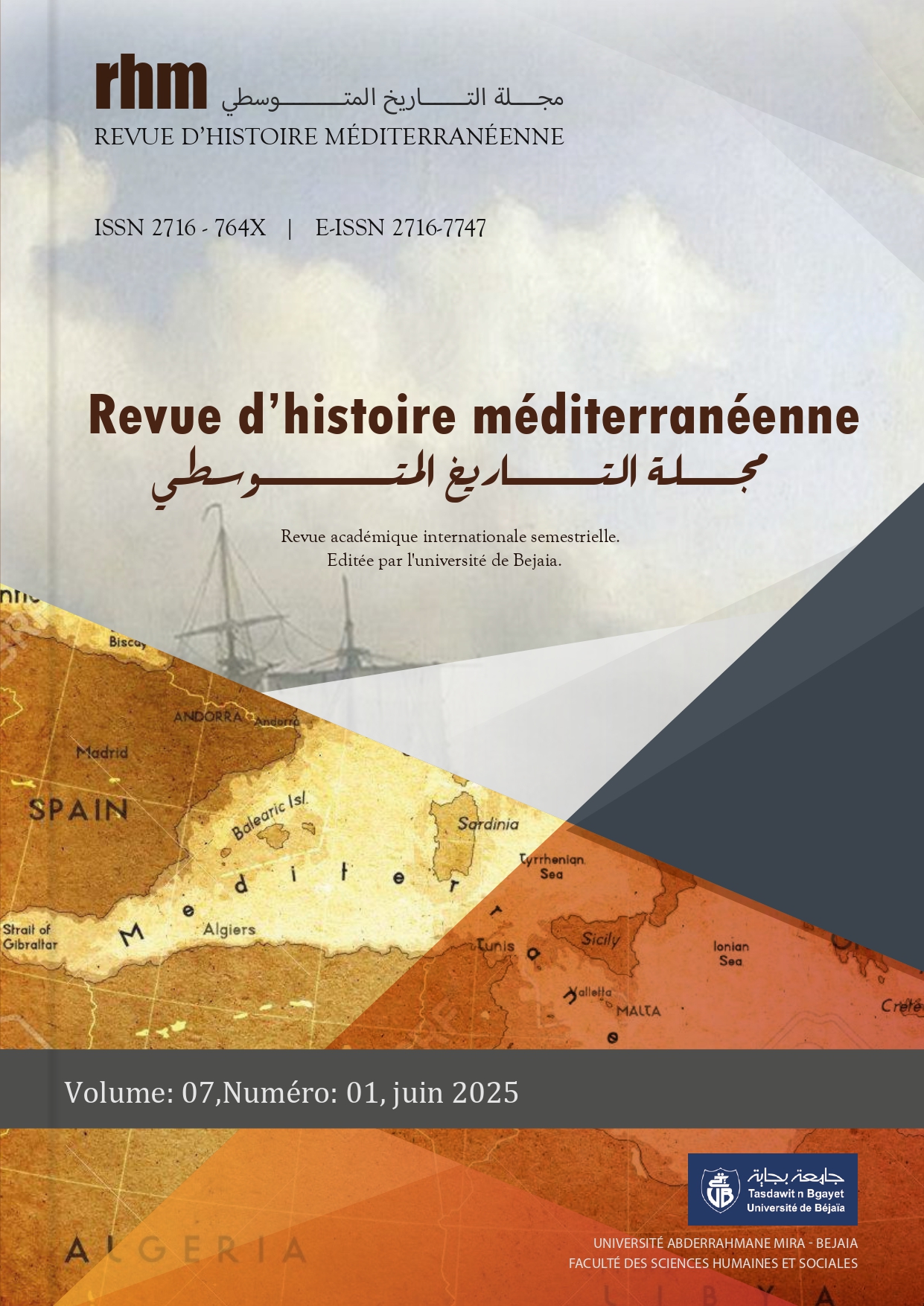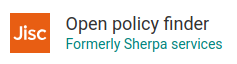Les relations entre les Européens et les Algériens musulmans à Constantine (1837-1934)
The relationship between Europeans and Muslim Algerians in Constantine (1837-1934)
Résumé
En 1837, la ville de Constantine est prise par l’armée française après un siège meurtrier. La population allait subir les affres d’une colonisation dure. Une population européenne est installée dans la ville dans un quartier séparé des autochtones. Peu à peu, d’autres quartiers destinés aux Européens voient le jour. Ce développement de l’immigration européenne est naturellement suivi par une grande activité économique dans leur quartier. En parallèle, les Algériens musulmans vivent au ralenti dans des quartiers difficilement habitables avec un niveau de vie semblable à celui des siècles passés. Les liens entre les deux communautés sont limités. Les hommes et femmes se croisent dans les marchés et parfois dans des lieux de travail. En général, ces liens n’étaient pas bons. Les causes sont à chercher du côté de l’administration coloniale et des colons. Ces derniers étaient arrogants ; ils considéraient les autochtones comme des ennemis à éviter ou à éloigner. Cet esprit de domination chez eux faisait partie intégrante de leur culture. Le régime colonial a encouragé cette séparation entre les deux entités par ses lois discriminatoires et son positionnement en faveur des colons en matière de financement ou de développement économique en général. La discrimination a également touché le volet politique en l’occurrence la représentation dans les assemblées régionales comme cela est indiqué dans la loi de 1919 ou la question de la citoyenneté comme le préconise le projet Blum Violette. Cette méfiance pouvait aller jusqu’à des affrontements violents comme ce fut le cas en 1934 entre les Musulmans et les Juifs de Constantine. À noter aussi la méfiance des autochtones alimentée par les difficultés de la vie quotidienne contrairement au niveau de vie des Européens qui était nettement supérieur. Les années passaient et la situation ne changeait pas. Ce manque de contact entre les deux communautés n’a pas pris fin qu’avec l’indépendance du pays. Comme question principale de recherches, on peut avancer celle-ci : quels étaient les liens économiques, culturels, politiques et sociaux établis entre les Européens et les autochtones à Constantine ? L’objectif de cette étude est d’essayer de comprendre le type de rapport que peuvent avoir deux populations qui n’avaient pas le même statut juridique et politique et qui étaient radicalement différentes l’une de l’autre, au moment où l’une d’elles vivait sous un régime colonial brutal. Elle s’appuie sur un rapport d’archives détaillé rédigé par l’Amicale des bachaghas, aghas et caïds du département de Constantine, un autre document concernant le massacre de 1934, et d’autres sources imprimées de l’époque des faits, comme celle du gouverneur général Maurice Violette. Pour approcher le sujet, il a été choisi d’évoquer les liens des deux communautés à travers plusieurs éléments à savoir : l’espace où elles habitaient, les débuts de la colonisation à Constantine et ses effets sur les autochtones, la question de la discrimination, l’influence européenne, le mécontentement des autochtones, et la violence, avec comme exemple les évènements de Constantine de 1934. Comme résultats de la recherche, il y a lieu de signaler que les causes qui faisaient que les relations entre les deux communautés n’étaient pas bonnes pouvaient être cherchées dans la nature du régime colonial, la disparité économique et politique entre les deux entités, ainsi que la mentalité des colons qui regardaient l’autochtone avec un regard de dominateur.