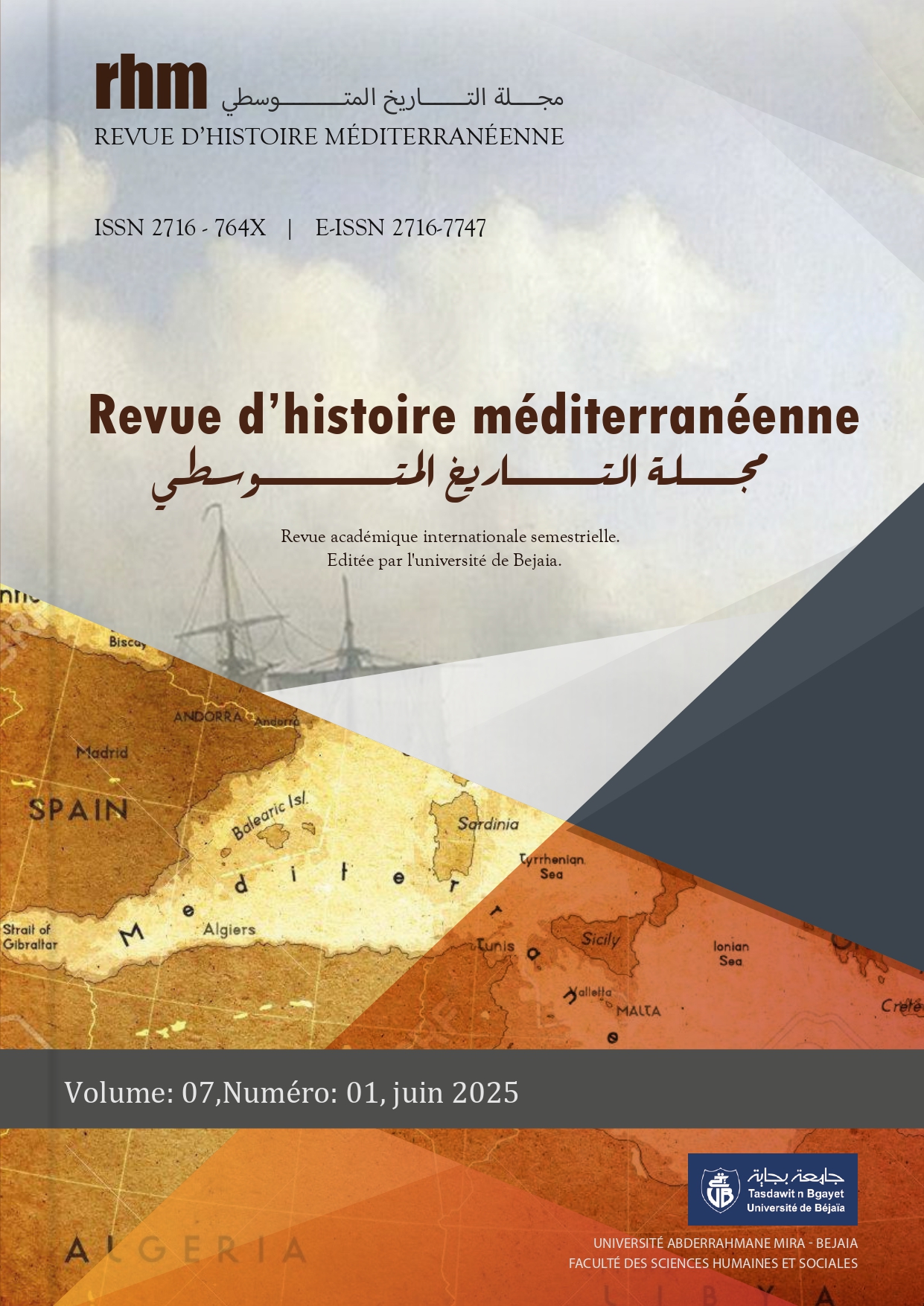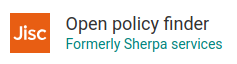Dialectique entre architecture et peinture dans les archives : Le cas du palais Ahmed bey de Constantine (1826-1985)
Dialectic between architecture and painting in the archives: The case of the Ahmed Bey palace in Constantine (1826-1985)
Résumé
La production urbaine et architecturale de la période ottomane tardive en Algérie n’a suscité l’intérêt des scientifiques chercheurs qu’à partir de la fin des années 1990. Cette prise de conscience, relativement récente, a causé des insuffisances en matière de documentation historique, laissant de nombreux édifices de cette époque partiellement étudiés. Cette absence de sources et d’analyses approfondies explique, en partie, les restaurations réalisées sans études historiques préalables, faute de références documentaires. Parmi ces édifices, nous citons le dernier palais beylical édifié en Algérie : le palais Ahmed bey de Constantine (1826-1835).
Le palais présente un décor mural peint illustrant, en partie, des villes du Moyen-Orient et de la Méditerranée. Bien que d'une grande originalité, ces représentations demeurent largement méconnues et peu documentées par les sources archivistiques. Celles-ci ont été produites généralement pendant la période coloniale française. Ainsi la production de connaissances sur cet héritage constitue une étape fondamentale pour sa reconnaissance et sa valorisation. Cet article, qui s’inscrit dans le cadre d'une thèse de doctorat en cours, s’appuie sur l'examen de plusieurs sources archivistiques textuelles, graphiques et iconographiques. Elles proviennent de divers centres d’archives, en Algérie comme en France. En Algérie, elles sont issues du centre des Archives Nationales d’Algérie et du Centre des Arts et de la culture palais des Raïs (Bastion23) à Alger. En France, elles incluent les fonds du Service Historique de la Défense (SHD) à Vincennes, ceux de la Médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP) (anciennement Médiathèque de l’architecture et du patrimoine) à Paris, ainsi que ceux des Archives départementales de la Somme à Amiens. Certains de ces documents exploités constituent une source de première main pour les recherches consacrées au palais d’Ahmed bey.
Pour appréhender cet ensemble décoratif, il est essentiel de restituer le cadre architectural dans lequel il s'inscrit. Par ailleurs, la procédure de classement du site parmi les monuments historiques d’Algérie, engagée dès 1901, gagne à être étudiée au regard de sa contribution à la reconnaissance et à la mise en valeur du palais. Les acteurs publics et privés impliqués, qu'ils soient civils ou militaires ont également été identifiés. Cette approche archivistique systématique nous a permis de compléter la genèse historique du palais en apportant des éléments de réponse aux questions liées à la datation de ce décor mural peint et à la chronologie des restaurations subies depuis la prise de Constantine en 1837, et ce jusqu’à après l’indépendance de l’Algérie. Cependant, ces résultats montrent que cette démarche, à elle seule, ne suffit pas pour prétendre à des conclusions exhaustives. Une approche interdisciplinaire croisant les données archivistiques, iconographies et techniques permettra d’aborder avec précision ces questions. Ainsi, les perspectives ouvertes par cette étude constituent dès lors un référentiel pour guider les projets de restaurations à venir.