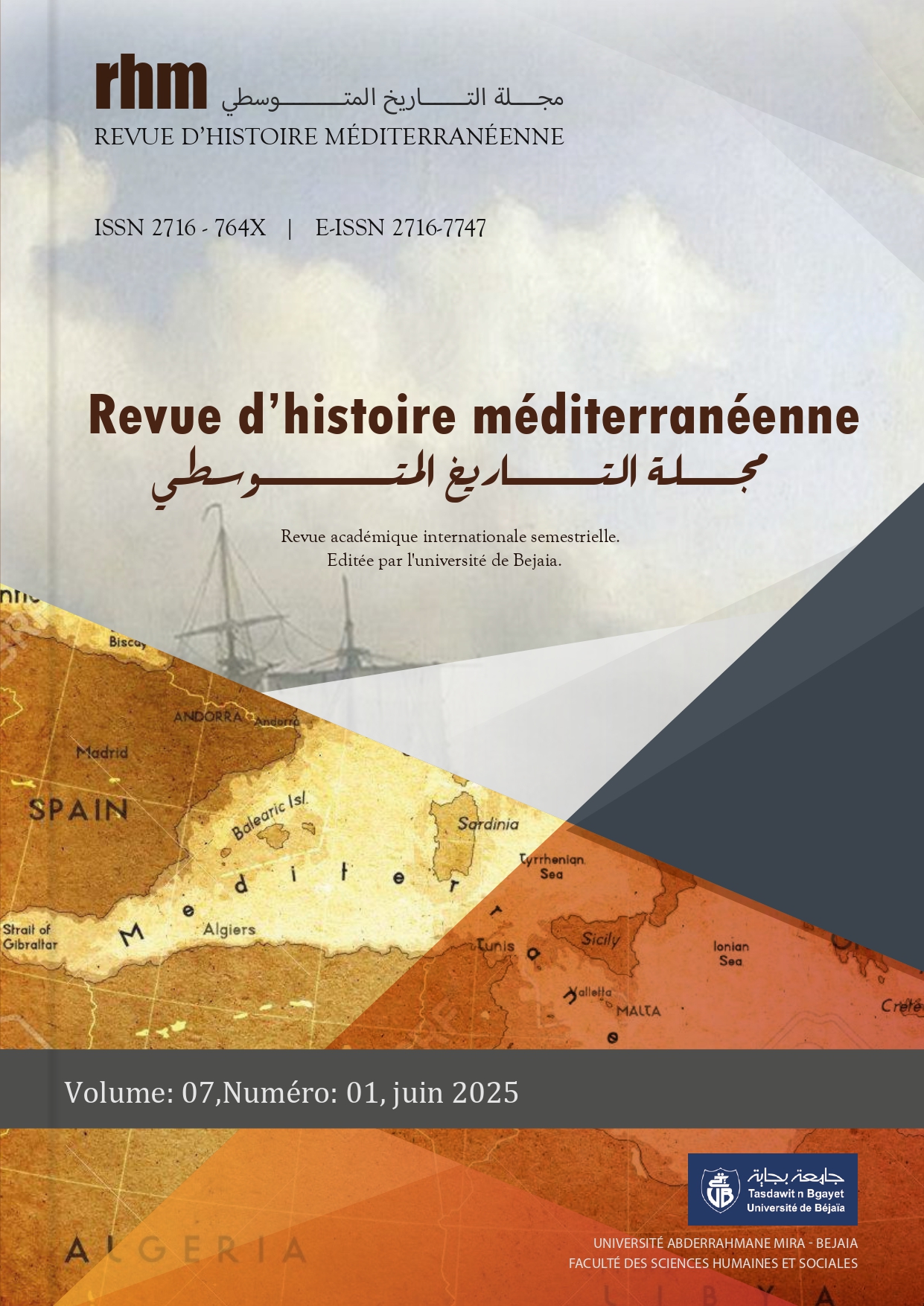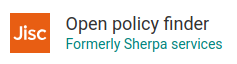L’assemblée villageoise (Tajmaɛt) pendant la colonisation : Mise sous tutelle, marginalisation et continuité
Résumé
Cet article a pour objet l’étude de l’évolution des assemblées politiques, tijumaɛ, kabyles pendant la période coloniale. Plus précisément il vise à comprendre quel a été l’impact des mesures prises par le pouvoir colonial sur ces institutions, après sa victoire militaire, pour administrer et contrôler la Kabylie
La problématique mise en avant dans cette étude est de comprendre comment les autorités militaires et administratives françaises ont misé et manipulé ces assemblées, après avoir soumis et restreint leurs prérogatives, pour administrer et asseoir leur domination sur le pays, et dans quelles mesures, la population et ces assemblées ont su réagir contre les mesures de marginalisation et d’instrumentalisation mises en place et développer des stratégies qui ont permis à ces assemblées de se maintenir face à cette politique.
Le corpus de cette étude repose sur une analyse approfondie des archives administratives, militaires et études françaises ainsi que les témoignages oraux de la mémoire collective kabyle. Ces sources ont été croisées pour en saisir les principaux enjeux et conséquences de cette politique et approfondir nos connaissances quant aux transformations des assemblées à l’épreuve de la colonisation.
Les résultats de l’analyse montrent principalement que le pouvoir colonial a œuvré, sous « le régime du sabre », à neutraliser ces institutions pour en faire un outil de contrôle et de domination de la population, sous l’autorité des militaires des bureaux arabes, lui permettant, provisoirement, d’administrer indirectement la région. Mais, après l’instauration et le renforcement des institutions administratives coloniales et la répression de la révolte d’El Mokrani, ces assemblées ont été progressivement marginalisées, sous prétexte qu’elles y ont participé activement, passant ainsi à une administration plus directe de la région et marquant une rupture dans la relation entre ces assemblées et le pouvoir colonial. Malgré ces mesures de contrôle et de marginalisation, la population kabyle a pu préserver et maintenir ses assemblées, qui continuent de garder leur légitimité, de manière clandestine, en continuant de fonctionner en parallèle des institutions coloniales. Et en fonction des rapports de force, ces assemblées kabyles, même si elles s’estompent temporairement devant les services de l’administration coloniale, se reconstituent lorsque la situation leur est favorable influençant parfois les institutions introduites par le pouvoir colonial.
En somme, cette recherche montre que la colonisation française a eu des conséquences importantes sur les assemblées kabyles, que les Kabyles, grâce à leur résilience, ont pu développer des stratégies leur permettant de s’opposer aux restrictions et à la domination du pouvoir, et de préserver leurs assemblées villageoises.